OO
lyrique, sensible, lucide
Pop rock, jazz
Déroutant au début, tant il n'est pas ancré dans un endroit bien cerné, mais vole au contraire vers de vagues étendues, par touches enfiévrées. La tension, le magnétisme d'une guitare acoustique sont retranscrites et amplifiées, prenant au départ un essor à l'exaltation académique, puis les amarres lâchent, guidées au son d'une voix nuancée dans la lignée de celle de Conor O'Brien (Villagers). Les amarres, c'est parfaitement en phase avec le sentiment de transit du refrain, We have been waiting here for too long. Il y à la fois la tension statique, contenue dans un orage de saxophone et de trompette, et le mouvement nébuleux d'aspirations aériennes. Puis une guitare espagnole.
Da Capo semble rechercher la voie charnelle en même tant que l'élan vers les choses diffuses. Le chanson titre offre un virement surprenant, nous place dans une situation plus délicate, tourne un sentiment tragique en instants qu'il faudrait saisir en funambule. On pensera plus loin au funambulisme de Robert Wyatt. A. Paugam pousse ses contemplations vers l'insolite. Le refrain, rassemble les fractions éparses dans une mélodie bizarre et réussie.
L'évocation de l’Espagne est de retour, comme le thème d'un voyage abstrait, avec You Really Don't Know. Voyage fait de ressentis et progressant par vibrations sourdes, dont la fraction évidente est dans la veine pop folk classieuse. Les chœurs rappellent l'album A Church That Fits Your Needs, de Lost in the Trees, un trésor américain que je conseille chaleureusement aux français de Da Capo. Il y a la même propension à faire pénétrer les chansons en territoire païen mais sacré.
On pense à Villagers surtout sur le plus enlevé I Fell in Love, A. Paugam joue du timbre de sa voix à gorge déployée, c'est un instrument dont il restitue toute l'émotion et le désarroi. On l'imagine, les yeux fermés, se rendant à la note juste, la tête inclinée, les coins de la bouche relevés, figés un instant en une expression de dévotion et de félicité.
Dès lors, on se laisse amener au gré des arrangements, par exemple sur la très intense Heal Me, qui assoit l'élégance et la verve jazz de Da Capo. On a l'habitude, dans la pop, de cuivres ; mais ici, rejoints par d'autres sonorités, ils vont plus loin, consument l'énergie, absorbent notre rythme de marche et nous laissent flotter pour atteindre des lieux idéels.
https://dacapo1.bandcamp.com/album/oh-my-lady
https://dacapo1.bandcamp.com/album/oh-my-lady




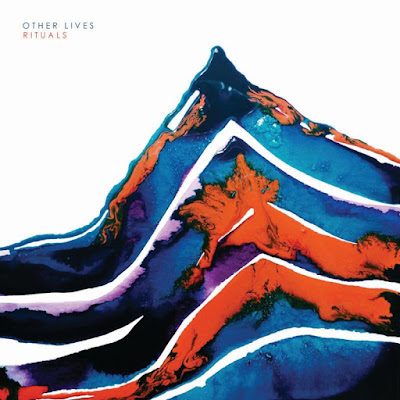










.jpg)




.jpg)