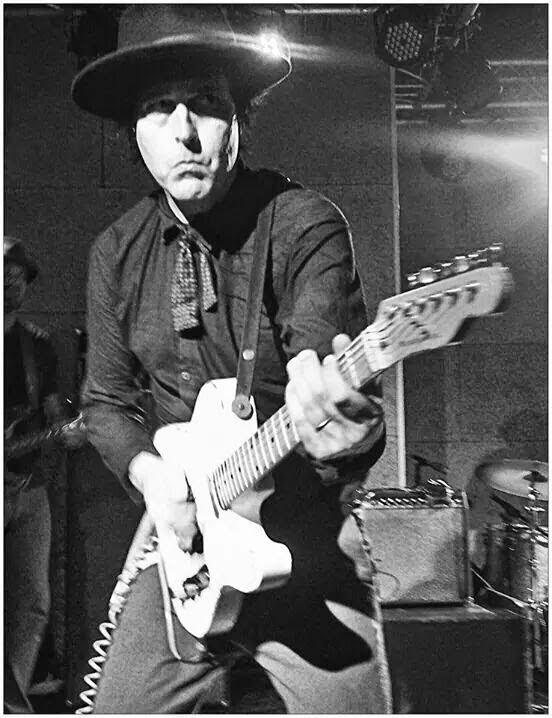Ecouter Kaputt, le dernier disque du groupe pop rock Destroyer, est dans mon souvenir comme de manger une glace artisanale à la cannelle sur un plage de l'atlantique. Non que les souvenirs soient liés, mais il conjurent un peu les même images de sensualité, de plaisir, et surtout, après coup, le souvenir de la futilité de ce plaisir et de cette sensualité. Il est d'autant plus difficile de remonter à la source d'une fascination pour Destroyer quand on ne connaît que cet album, que tout le reste, les sirènes d'une carrière bâtie sur un certain détachement, est dans les embruns.
Pourtant, Kaputt concentre beaucoup ce qu'a mené Dan Bejar depuis des années ; selon ses propres mots, il est plus sauvage, certes : mais c'est parce que son chant détaché laisse plus de place pour la musique et les doutes stylistiques du type : est-ce que c'est bien si je multiplie les solos de saxo ? Même s'ils en existe chez Primal Scream ou Bark Psychosis, et allons, y, même chez Lou Reed et les Rolling Stones ? Aux dires de Dan Bejar, le 'magicien' (le titre d'une chanson méconnue de Lou Reed) derrière le projet Destroyer depuis le milieu des années 1990, Kaputt a pris 10 fois plus de temps à enregistrer que les huit autres albums qu'il a essaimés au fil du temps. « La musique a été construite petit bout par petit bout. Parfois, c'était difficile de coller avec autant d'idées disparates. » Si on prend sa carrière, Bejar amène aussi des commentaires et des remarques disparates qu'il est bien difficile de rassembler de façon cohérente. Surgissent pêle-mêle son admiration pour David Bowie, sa façon dilettante de dérouter, son amour de la poésie et l'affirmation tardive qu'il pouvait devenir crédible sans se cacher derrière ses musiciens, comme chanteur acoustique ; les paradoxes pseudo-littéraires, ses racines espagnoles, sa relation je t'aime-moi-non-plus avec ses 'fans'... Certains album, comme Streehawk : a Seduction, l'ont révélé. D'autres ont été réhabilités avec le temps, c'est le cas de Your Blues, que sa maison de disques réédite en vinyle fin 2014, pour en célébrer les 10 ans. Quand à Kaputt, il a permis à de nouvelles personnes de découvrir Destroyer ou de jeter un regard neuf sur son ancien travail. C'est à peu près à ce moment que les termes de 'sage' ou de 'magicien' ont été appliqués à Bejar, sans vouloir sciemment oublier tous les nombreux musiciens qui rendent un tel album possible, et qui font de Destroyer un projet à taille variable.
Kaputt a demandé ce travail car il est une réincarnation pour Destroyer. Réincarnation car il est organique. C'est là que Bejar a le mieux fait preuve de sérieux, après des années à avoir fait preuve d'une attitude appliquée, à défaut d'être complètement dévouée, des années de concerts presque sans échanger un mot avec son public, et les deux sont liés plus qu'on ne l'imagine. Enfin, en s'abandonnant à la pop riche et iconoclaste on a l'impression que Destroyer symbolise énormément pour Bejar, sans pour autant faire l'effort que demanderait sa poésie absconse si elle était publiée dans un livre. On y revient car malgré sa démarche plus John Lennon (« J'écris de la poésie pour moi-même », chante t-il à un point sur Kaputt) que Paul McCartney, il avait sorti alors un album agréable, limite sociable, dans lequel se perdre, nous susurrant des phrases tout en nous donnant l'impression d'un drame à l'oeuvre. Désosser cet album, donnait plus que jamais l'aperçu de comment fonctionnait l'esprit de Bejar, quelles fascinations étaient les siennes, et ainsi il se rapprochait un peu plus des fans qui l'adulent patiemment. Son disque, plein de son éhontés, restait un acte de défiance. Mais autrefois, il agissait comme s'il savait que sa musique remporterait toujours un certain succès, parce qu'elle était oblique ; tandis que maintenant il voulait redresser ses torts, plongeant sa sincérité, ses moments dédiés à la mort et à l'amour. C'était un triomphe d'avoir cette œuvre si entièrement sereine qu'elle projetait des images et agissait comme un film d'auteur en bord de mer.
Dfficile d’imaginer le son de Destroyer sans les solos de saxophone, les flûtes, la basse fretless, ou la présence abondante de chœurs féminins sensés souligner la sensualité à l’œuvre. Pourtant, tout cela n’existait pas avant Kaputt, qui redonna sa fraîcheur à Destroyer en utilisant la batterie émotionnelle, non plus de David Bowie comme auparavant, mais de Brian ferry. Destroyer, on se demande si c’est l’album qui devait pousser les 'fans' abasourdis dans leurs derniers retranchements, ou l’œuvre sérieuse d’un homme qui agit en pleine connaissance de cause, éprouvant même le besoin sincère de ‘laisser une bouteille à la mer’ pour conseiller aux critiques de ne pas être trop honteux envers eu mêmes lorsqu’ils se déchaîneront sur l’album. Au final 'on' l'a adoré. Mais quand même, amusant ce revirement sensuel, incongru à un stade de sa carrière où Bejar a tout du bon père de famille berçant son gamin pour l'endormir.
La relation de Bejar a son public, patient et encore plein d'ironie parfois, est intéressante, pour quelqu'un qui l'a découvert trop récemment. Si on veut saisir l'essence de cette musique, il faut trouver sa propre manière de l'adresser. il faut s'imaginer écouter Kaputt en marge d'un festival du cinéma de San Sebastian. Ou dans un port de plaisance quelconque. La clef de cette musique est peut être le lieu ensoleillé : légèrement impersonnel. L'écouter au casque, chez soi ? Un source me dit que c'est seulement pour Kaputt que ça devient utile, car l'album fourmille effectivement de détails. Pourtant, Bejar vante 'l’élégance de la pièce vide'. Mais aussi sur la plage, où Dan Bejar affectionne de faire des concerts. Sa musique est comme le sable qui va et vient avec les marées, et Kaputt, avec ses thématiques littéraires, à la limite du saisissable, l’a mieux que jamais montré. Quelque part, en sortant le premier classique des années de la décennie 2011-2020, Bejar s’est offert de luxe d’éteindre le mépris de ceux qui ciblaient indifféremment Destroyer ou les journalistes s’excitant de la 'prétention' de Bejar. Prétention, soi-disant, de vouloir mettre de la littérature dans la pop, sans qu’aucune référence littéraire crédible ne vienne appuyer cela. Avec Kaputt, a été évoqué Oscar Wilde. Bejar s’y connaît en indifférence. Toute son œuvre peut être vécue comme une réflexion sur le détachement. Un autre raison de l'écouter sur une plage espagnole ? Les accointances de Destroyer avec ce pays se sont révélées sur Five Spanish Songs (2013). Un problème demeure : le malin Bejar vit à Vancouver, dans le froid canadien.











.jpg)
.jpg)