Avec
le trio vocal des Abyssinians culmine la force du message rasta. Le
succès de leur approche résolument spirituelle et fraternelle de la
musique, est reflété par une chanson, Satta Massagana, qui va
devenir contre toute attente l’hymne national officieux de la
Jamaïque. Tout était loin d’être gagné cependant ; les
rythmes ont beaucoup ralenti depuis le ska, les chansons sont souvent
en mode mineur, ce qui leur confère un aspect triste et sombre, les
tempos ne varient pas d’un morceau à l’autre, et la
voix de Bernard Collins, bien que profonde, est peu impressionnante
en comparaison avec celle, beaucoup plus soul, de Leroy Sibbles (The
Heptones). Mais tout le trio chante, avec un sens de l’harmonie
naturel. Et le studio n’est plus équipé de deux mais de huit
pistes qui permettent un son plus profond, résonnant d’un
sentiment spirituel. Huit pistes, c’est encore bien en deçà de ce
que les Beatles connaissaient à Abbey Road…
Bernard
Collins et Donald Manning sont amis de longue date, mais l’idée de
faire de la musique de manière professionnelle ne leur vient
qu’après qu’un flot créatif ait apporté Satta Massagana. Une
chanson de dévotion dont le titre est en Ahmaric, la langue
éthiopienne. La chanson elle-même est inspirée par Happy Land de
Carlton & the Shoes. Coxsone Dodd, le célèbre producteur,
enregistrera la chanson mais restera pessimiste quant à son impact
sur le public acheteur. Il a pourtant également produit Happy Land…
Sans support, elle ne se vendit pas. Il fallut que le groupe rachète
les bandes (beaucoup plus cher que ce qu’ils avaient reçu pour
enregistre la chanson), et la sorte sur leur propre label, Clinch.
« Quand nous fîmes la chanson, elle ne décolla pas. Elle date
de 1969 et elle ne se vendit pas du tout jusqu’en 1971. »
Voyant le succès surprise du morceau, Dodd tenta de rattraper le
coup en produisant plusieurs versions instrumentales qu’il mit
rapidement en vente. Lui qui avait accompagné l’avènement du ska
puis du rock-steady, la douceur et la douleur subtilement contenues
dans le reggae semblaient avoir échappé à sa sensibilité.
Rejoints
par Lynford Manning (un habitué de Carlton & the Shoes), les
Abyssinians produisirent notamment Declaration of Rights, un appel à
la révolution qui venait droit du cœur. « They
took us away from our civilization, brough us to slave in this big
plantation.” Leur
premier album enfin paru en 1976, s’appellera Forward to Zion (le
mot ‘Zion’, beaucoup utilisé par les rastas, décrit une
sphère spirituelle, un paradis des sens). African Race est l’un de
ses temps forts thématiques, évoquant violence et domination
coloniales. La relative austérité et les vérités fondamentales
auxquelles semble toucher Forward to Zion et son successeur, Arise
(1978), laissent entrevoir une musique accompagnée d’un nouveau
pouvoir ; celui de trouver un équilibre moral et de le
partager.
Explorateurs
& Pirates
Si
la Jamaïque est pleine de talents, la renommée locale ne leur
apporte pas la richesse, loin de là. Ils sont souvent payés 20
dollars par chanson enregistrée et n’ont pas de royalties. Un
studio tel que Studio One est avant tout apprécié par les musiciens
comme une école, pour ce qu’ils y apprennent. Les plus chanceux
sont ensuite repérés par de plus grosses maisons de disques. « Il
n’y avait pas d’argent car nous étions comme des explorateurs,
raconte Léonard Dillon, des Ethiopians. Avant d’entrer dans le
business, je pensais que ça changerait notre vie, mais une fois à
l’intérieur on se rend compte que rien ne se passe. La musique
n’avait pas de répercussions à l’étranger. J’étais
sous-estimé, parce que je ne chantais pas dans un bon anglais. »,
remarque Dillon qui souligne que nombre d’artistes locaux
abandonnaient leur argot pour essayer de perçer. Situation rendue
encore plus amère lorsqu’on sait que nombre d’artistes
Jamaïcains étaient diffusés sans autorisation en Angleterre, des
versions pirates de leurs disques se vendant sans que personne,
apparemment, n’y trouve rien à redire. « Le premier disque
que vous faites, vous vous le faites voler », commentera Donald
Manning, des Abyssinians. Léonard Dillon : “Mais nous ne
pensions même pas à l’argent. Même si le producteur ne nous
donnait rien un jour, nous étions quand même au studio en train
d’enregistrer le lendemain. » A Trench Town, il n’y
avait rien d’autre qui aurait pu les détourner de la force d’un
héritage ancestral. Un travail, souvent manuel et pénible, leur
permet de vivre.

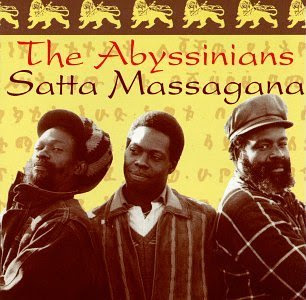
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire